Le deuil est un processus, personne ne remet cela en doute. Cependant, on considère trop facilement qu’il s’agit d’un processus temporel, dans le sens où il s’agirait d’un travail qui se fait en fonction du temps qui passe ; c’est le fameux « le temps guérit toutes les blessures » que l’on servira facilement à un proche en souffrance. Le problème, c’est que le temps ne guérit jamais les blessures, nous ne faisons que nous habituer à vivre avec au point de ne plus réellement sentir qu’elles existent. C’est la différence entre ne plus souffrir et ne plus sentir que l’on souffre. Avec le temps, le corps s’habitue à la douleur, il s’anesthésie, l’intègre comme une normalité. La cause de la souffrance est toujours bien présente, mais on est parvenu à en ignorer les effets.
Le deuil est bien un processus, mais il n’est pas réellement dépendant du temps qu’on lui attribue, ou en tout cas, pas dans les proportions et les considérations avec lesquelles on l’aborde souvent. Dans cette idée de processus, beaucoup sont familiers avec les fameuses 5 étapes suivant le choc émotionnel d’un deuil pour aller jusqu’à une possibilité de reconstruction, à savoir :
- Déni
- Colère
- Tristesse
- Résignation
- Acceptation
Cela nous renseigne effectivement sur les différentes étapes émotionnelles que l’on peut traverser, et sur lesquelles on s’attardera plus ou moins, cependant, cela ne nous dit rien sur ce qu’est le processus du deuil en lui-même, ni même s’il est possible de le traverser plus rapidement ou plus efficacement.

Cela pourrait sembler étrange de parler de rapidité ou d’efficacité pour une telle expérience, et beaucoup refuseraient de considérer cette idée de peur de s’infliger un bonne dose de culpabilité à la perspective d’essayer de « tourner la page » plus rapidement, mais il y a une grande différence entre terminer un deuil et ne plus penser à la personne (ou l’animal, ou la chose que l’on a perdu). Faire un deuil plus rapidement et efficacement nous permet justement de dépasser la détresse émotionnelle pour pouvoir se reconstruire, mais surtout reconstruire la relation avec ce que l’on a perdu.
Toute la compréhension d’un deuil, et donc notre capacité à le traverser, tient au fait de savoir exactement ce que l’on a perdu. La plus grosse problématique, et ce qui inflige le plus de souffrances sur les durées les plus longues, survient lorsque l’on ne comprend pas la nature exacte de ce que l’on a perdu. Certes, beaucoup argueraient que lorsque l’on perd un proche, on sait exactement ce que l’on a perdu, et dans la majorité des cas, ils se tromperaient, car ce n’est jamais réellement la personne que l’on perd, mais l’idée que l’on s’est construite d’elle.
Pour faire simple, on ne connait jamais une personne, même la plus proche de soi. On n’interagit jamais avec elle directement, mais avec notre objet mental d’elle. Et trop souvent avec le temps, on ne cherche même plus à savoir qui est vraiment la personne en question. Notre esprit ne se repose que sur l’objet mentale que nous avons construite au fil des interactions, en fonction de nos perceptions, de nos projections, de nos attentes, de nos préférences, de nos croyances, de nos conclusions,… bref de la réalité que l’on s’est construite. On ne sait pas qui est la personne en face de nous, on ne connait que notre construction mentale, aussi subjective soit-elle.
Donc, lorsqu’une personne décède, ce n’est pas uniquement la personne que l’on perd, sa présence, les interactions sociales et affectives possibles, c’est aussi cette construction que nous en avons faite et à laquelle nous avons rattachées un ensemble d’identifications et d’attentes. La partie « évidente » du deuil consistera donc à arriver à l’acceptation que l’on ne pourra plus ressentir la présence physique de la personne, qu’il est désormais impossible d’interagir avec. C’est cette partie sur laquelle on se concentre, car c’est celle-ci qui nous semble la plus douloureuse. Bien évidemment, cela induit trop souvent que l’on ne prête pas attention à cette autre partie que l’on a perdu : cette partie de nous qui souffre de voir que ses besoins ne seront plus satisfaits, que ses peurs ne seront plus apaisées.
Paradoxalement, c’est le plus grand obstacle à la résolution d’un deuil, la plus grande difficulté, mais aussi celle que l’on aura le moins facilement tendance à considérer du fait que cela semblerait profondément égocentrique, dans le sens péjoratif du terme, générant potentiellement de la culpabilité. « Et moi dans tout ça ?! »… est pourtant une considération essentielle. Dans la construction mentale que l’on avait fait de l’autre personne, il existait :
- des identifications. C’est-à-dire ce qu’elle représentait pour nous, ses rôles, ses fonctions, ses capacités à satisfaire certains besoins que nous lui avions inconsciemment imposées (sans forcément qu’elle le sache d’ailleurs).
- des attentes que l’on avait placées sur elles. Des attentes pour faire certaines choses, pour satisfaire les besoins et apaiser les peurs liées à nos différentes identifications. Cela pourra par exemple être le fait de se dire qu’un parent ne sera plus là pour nous rassurer (même en tant qu’adulte) dans un période difficile ; c’est la personne que l’on sait être là pour nous lorsque l’on se retrouve dans certaines situations,…
- une partie de notre construction égotique. D’une certaine manière, nous nous définissons en fonction de cette construction mentale de l’autre, et c’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un parent puisque notre construction égotique s’est faite sur la base de ce que l’on a intégré de nos deux parents dans nos premières années de vie. C’est cette partie de l’autre que l’on introjecte et qui fait partie de nous.
Cela revient à dire qu’il y a un deuil de nous-mêmes à faire aussi, que cette partie est probablement la plus importante et complexe et pourtant celle à laquelle on ne fait même pas attention trop souvent. Nous sommes tellement focalisés sur la disparition de la présence de l’autre, que l’on ne se tourne pas vers nous-mêmes et que l’on n’ose pas se dire qu’il faut penser à être triste pour soi, pour cette partie de nous que l’on a perdue.
Etrangement, c’est pourtant cette part de nous en souffrance qui réveille la colère comme deuxième étape du deuil. Nous ne sommes pas en colère parce que l’on a perdu un proche, que notre entreprise a fait faillite, qu’une relation s’est terminée, mais parce que cela induit qu’une partie de nous, de nos identifications, ne sera plus satisfaite. Une entreprise pourra satisfaire un besoin d’importance ou de sécurité, un partenaire pourra être celui qui apaise l’angoisse d’une blessure d’abandon ou de rejet qui n’a pourtant rien à voir avec lui, un parent pour satisfaire un besoin de protection,…
Le cerveau, lorsqu’il perd sa capacité à satisfaire ses besoins ou à apaiser ses peurs, rentre justement dans la peur, et va naturellement chercher à trouver une solution, tout d’abord dans la fuite (le déni), puis dans la lutte (la colère), avant d’accepter de se résigner à la perte.
Le processus de deuil doit donc impérativement passer par le fait de s’autoriser à être triste, non pas uniquement pour la perte de la personne, mais pour tout ce qu’elle nous apportait (matériellement ou pas), pour tous les rôles qu’on lui avait assignés, pour toutes nos attentes qu’elle n’aura plus la possibilité de satisfaire,… bref, de prendre un (long) moment pour faire le ménage dans nos constructions égotiques. C’est ce qui permet de faire un deuil efficacement car cela donne une véritable opportunité pour reconstruire la relation avec la personne sur la base de l’objet mental que nous en avions fait.
Le deuil est donc aussi une opportunité pour un travail d’introspection, mais une chose est certaine, la manière la plus efficace de faire le deuil de quelqu’un ou de quelque chose (après tout, tout et tous étant soumis au deuxième principe de la thermodynamique, nous n’avons aucune chance d’y échapper) est d’anticiper cette problématique en faisant ce ménage avant. Cela consiste donc à se débarrasser de ses identifications, de ses attentes, de ses peurs, tant que la personne est encore là. Cela consiste à dire ce qui doit être dit tant qu’on peut le faire, et à ne pas garder cela dans un coin en se disant que cela peut attendre, que ce n’est pas le moment. Cela veut dire que l’on ne doit pas se définir en tant qu’individu, en tant qu’être, en fonction des choses que l’on a ou que l’on fait. Cela veut dire que l’on doit essayer d’aimer l’autre pour qui il est, et pas seulement pour ce qu’il représente pour nous.
Cela veut dire que l’on doit apprendre à laisser nos illusions mourir à chaque moment de notre vie pour ne jamais avoir à en faire le deuil.
Vous pouvez retrouver de nombreuses réflexions sur notre relation à la mort dans mon ouvrage « L’apologie de la mort«
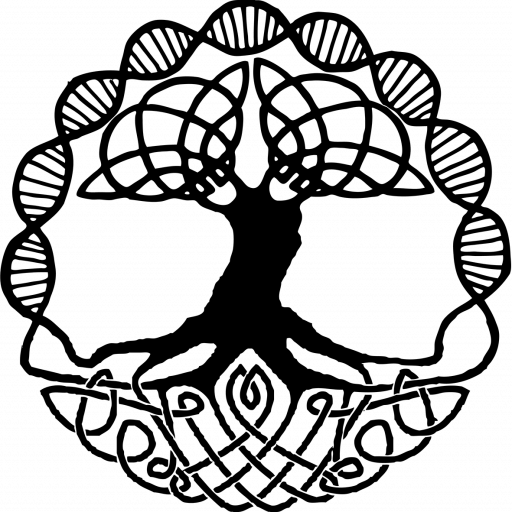


0 commentaires